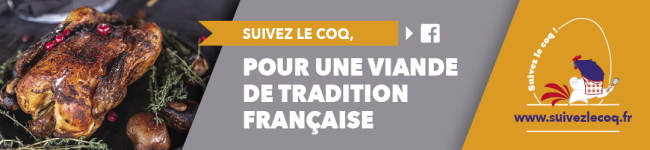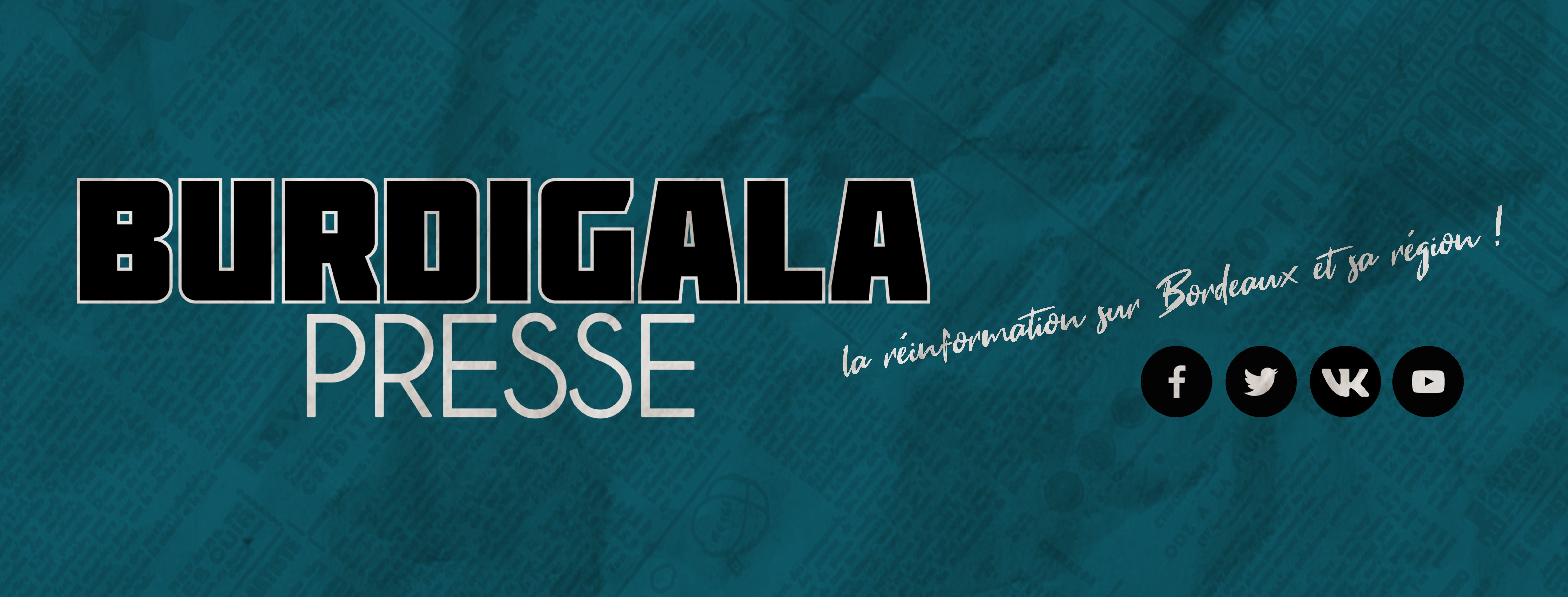Pendant que les plateaux télé dissertent sur l’antiracisme, que les experts universitaires relativisent la violence des quartiers et que les responsables politiques évoquent “les territoires perdus de la République” sans les nommer, une structure souterraine s’étend, contrôle, infiltre, et pèse sur la France d’aujourd’hui : la DZ Mafia.
“DZ” comme Dzayer, l’Algérie.
“Mafia” comme système de contrôle parallèle, de protection clanique, d’intimidation, et de rente par la terreur.
“DZ” : une désignation culturelle, géographique et identitaire
Le terme “DZ”, abréviation populaire de “Dzayer” (l’Algérie, en arabe dialectal), est largement utilisé dans la culture urbaine française pour désigner :
• l’origine algérienne réelle ou revendiquée,
• un sentiment d’appartenance communautaire transnational,
• une fierté post-coloniale nourrie d’un antagonisme historique vis-à-vis de la France.
La DZ Mafia désigne donc une nébuleuse ancrée dans cette sphère culturelle et identitaire algérienne, y compris chez les Français de nationalité mais de culture ou de loyauté différente.
Réseaux franco-algériens actifs
Plusieurs faits attestent de l’existence de réseaux criminels transnationaux franco-algériens, notamment :
• Des parcours de délinquants multirécidivistes ayant échappé à l’expulsion grâce à des jeux sur la binationalité, les failles administratives ou la protection juridique française.
• Des filières de blanchiment d’argent en Algérie (achat de biens immobiliers, de voitures de luxe, ou de commerces de façade).
• Des transferts de technologies de contrefaçon ou de produits interdits entre les deux rives.
• Un axe Marseille–Oran–Alger, historiquement documenté dans la drogue, les armes, ou les faux papiers.
Symbiose partielle avec l’État algérien
L’État algérien n’organise pas ces réseaux, mais il :
• bénéficie parfois indirectement de leur argent (investissements, corruption locale),
• refuse souvent de reprendre ses ressortissants expulsés par la France, en prétendant ne pas pouvoir les identifier,
• protège ses binationaux via ses services consulaires, refusant de reconnaître la perte de la nationalité algérienne.
Il existe donc une zone grise de non-droit diplomatique où la loyauté des individus à la France est sujette à caution.
Une mafia sans capo ni code d’honneur
À la différence des mafias italienne ou albanaise, la DZ Mafia ne repose pas sur une structure pyramidale. Elle fonctionne en réseau souple, éclaté, familial ou tribal, mais solidaire dès lors qu’un membre est menacé. On ne trouve pas un “Don” à la Corleone. On trouve des caïds d’immeuble, des parrains de quartier, des grands frères charismatiques, mais surtout des connexions culturelles et historiques communes :
• l’Algérie coloniale puis postcoloniale,
• les quartiers HLM de la Seine-Saint-Denis, de Lyon, Marseille, Grenoble, Roubaix,
• la haine du flic, du Français “gaulois”, de la République.
La DZ Mafia ne se réclame pas de la République algérienne officiellement — mais elle en hérite. Elle se nourrit d’un double rapport schizophrénique à la France : fascination pour ses richesses, mépris pour ses lois. Cette mafia ne cherche pas à s’intégrer au système, mais à le détourner ou le dominer, localement, par la ruse, l’intimidation et la menace.
Les piliers : drogue, faux papiers, OQTF protégés, réseaux de femmes
La DZ Mafia vit du trafic de stupéfiants, bien sûr. Du cannabis importé du Rif, de la cocaïne, de plus en plus, par les ports de Marseille et du Havre. Mais ce n’est que la surface.
Elle est aussi :
• fournisseur officiel de faux papiers pour migrants, délinquants ou militants islamistes,
• réseau de “passeurs légaux” dans l’administration (agents corrompus dans les mairies, CAF, Pôle Emploi),
• soutien logistique aux OQTF récidivistes : logements, planques, identités fictives,
• gestion parallèle de femmes (réseaux de prostitution voilée, mariages gris, “femmes à usage communautaire”).
Le tout avec l’appui indirect de certains collectifs militants, qui servent de boucliers moraux en cas de confrontation avec la police ou les journalistes.
La culture du silence : ni balance, ni trahison
Ce qui protège la DZ Mafia, ce n’est pas seulement l’illégalité. C’est la loi du silence, plus forte que la loi de la République. Dans de nombreux quartiers dits « sensibles », il est plus grave de parler à un policier que de commettre une agression.
L’État, lâche ou impuissant, n’ose plus rentrer dans certains secteurs. Des livreurs s’y font racketter, des pompiers caillasser, des élus menacer. L’école elle-même devient un territoire à conquérir, où certains profs doivent demander la permission d’enseigner certains sujets (Shoah, caricatures, égalité femmes-hommes) pour éviter les représailles.
Une protection politique et associative
La DZ Mafia prospère aussi grâce à une impunité stratégique. Toute dénonciation des réseaux communautaires mafieux est immédiatement interprétée comme un acte de “racisme systémique” ou “d’islamophobie”.
Les associations subventionnées, les élus clientélistes, les intellectuels indigénistes, et une partie de la gauche politique, qu’elle soit radicale ou gestionnaire, couvrent cette réalité au nom de l’antiracisme, de la diversité ou du « vivre-ensemble ».
On préfère qualifier la violence de « sociale », les braqueurs de « victimes d’inégalités », et les zones de non-droit de « quartiers populaires ».
Internationalisation : France, Belgique, Espagne, Maghreb
La DZ Mafia est transnationale. Des bandes françaises opèrent en Espagne, des relais algériens blanchissent l’argent à Oran ou Alger, des complicités politiques s’établissent au Maroc, en Tunisie, ou via des consulats.
Les rapports d’Europol identifient depuis 2018 les réseaux d’origine maghrébine comme « hautement structurés, mobiles, et extrêmement violents ». La Belgique et la France sont les deux zones les plus touchées par les ramifications DZ.
Un État dans l’État — et une société qui se tait
La DZ Mafia, ce n’est pas un fantasme. Ce n’est pas une légende urbaine. C’est un réseau sociologique, historique, ethnique et politique, enraciné dans les fractures françaises postcoloniales, protégé par le silence, la peur, la complicité.
Elle ne cherche pas à renverser l’État, elle veut le contourner. Elle ne pose pas de bombes, mais elle paralyse les institutions, gangrène les quartiers, caporalise les familles. Et elle colonise le réel.
La DZ Mafia : des Barbaresques sans navires
Parallèle historique et critique d’un aveuglement volontaire
« Si les Barbaresques capturaient des chrétiens sur les mers, la DZ Mafia capture la République de l’intérieur. »
L’héritage d’une logique de prédation
À la croisée de l’histoire et de la sociologie contemporaine, un constat s’impose : la DZ Mafia — ces réseaux criminels franco-algériens actifs en France — opère selon des principes étonnamment proches de ceux des pirates barbaresques qui, entre le XVIe et le XIXe siècle, rançonnaient l’Europe chrétienne depuis Alger, Tunis ou Tripoli. La mer a cédé la place au bitume des cités, les galères aux BMW volées, mais l’esprit reste : celui d’une économie du butin, d’une organisation clanique, et d’un rapport d’inversion symbolique envers le pays hôte.
Les Barbaresques bénéficiaient de la complaisance tacite de l’Empire ottoman ; la DZ Mafia, quant à elle, agit dans une zone grise juridico-politique, protégée par des refus d’expulsions de l’Algérie, des complicités communautaires, et un État français tétanisé à l’idée de nommer le réel.
Un État exploité comme un territoire conquis
Là où les pirates d’Alger pillaient les navires occidentaux, les mafias issues de l’immigration nord-africaine pillent aujourd’hui les caisses sociales, les dispositifs d’aide, les logements publics, les niches judiciaires, les failles migratoires. Elles n’attaquent pas frontalement la République, elles s’en nourrissent, la parasitent méthodiquement, la retournent contre elle-même.
La comparaison n’est pas métaphorique : ces réseaux ont établi des zones de souveraineté mafieuse, des quartiers entiers où l’État ne pénètre plus, où les codes de l’honneur tribal remplacent la loi, où la terreur et la solidarité clanique assurent l’ordre.
Un effondrement moral et politique
Ce phénomène n’est pas seulement criminel. Il est politique. Les bureaux du FLN en France, dès les années 1960, ont interdit à leurs compatriotes toute assimilation. L’État français, lui, a offert à ces populations des HLM modernes, souvent plus confortables que les logements des ouvriers français de souche, sans contrepartie culturelle ou civique.
Ce cocktail (mémoire de revanche + confort sans devoirs + encadrement ethno-politique) a produit un habitus mafieux, dans lequel le butin devient légitime, la loi française, injuste par essence, et la criminalité, un redressement symbolique du passé colonial.
Les Barbaresques de l’intérieur : tolérés, jamais nommés
Tout comme les puissances chrétiennes achetaient autrefois leur tranquillité aux Barbaresques par des rançons, la classe politique française pactise avec les chefs de quartier, les associations communautaires, voire les trafiquants, pour acheter la paix sociale.
Les élus locaux, surtout à gauche mais aussi au centre-droit, délèguent l’ordre à ces pouvoirs parallèles, tolèrent les trafics en échange de paix électorale et ferment les yeux sur la pénétration d’un islam politique et mafieux, incarné aujourd’hui par des réseaux fréristes, indigénistes ou salafistes.
Conclusion : une piraterie qui ne dit pas son nom
Non, la DZ Mafia n’est pas une dérive isolée. C’est le symptôme d’un double échec : celui de l’assimilation que l’État n’a pas osé exiger, et celui de l’autorité qu’il n’a pas su imposer.
Comme les Barbaresques, les mafias issues de l’immigration profitent de nos divisions, de notre lâcheté, de notre déni du réel. Et si nous ne reprenons pas le contrôle de ces zones, si nous ne dénonçons pas les pactes locaux de non-agression, si nous continuons à acheter la paix à crédit, nous perdrons tout : l’État, la loi, la nation.
La DZ Mafia : des Barbaresques sans navires :
« Si les Barbaresques capturaient des chrétiens sur les mers, la DZ Mafia capture la République de l’intérieur. »
David Duquesne